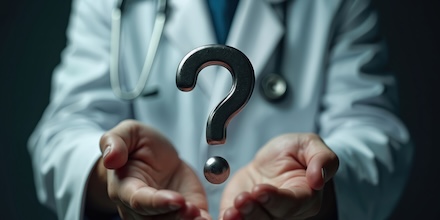Alors que la résiliation à tout moment de l'assurance de prêt immobilier a passé la première étape parlementaire, nombreux sont les emprunteurs à ignorer qu'ils peuvent changer de formule en cours de crédit. Une lacune qui leur fait perdre dans l'immense majorité des cas de précieuses économies. La législation en place permet de substituer le contrat initial par une offre alternative à couverture au moins équivalente, mais sans accès à une information précise et complète, difficile de faire valoir ce droit. En attendant un dispositif simplifié, qu'on espère effectif dans un peu plus d'un an, voici comment réduire le coût de l'assurance en changeant de contrat.
La délégation d'assurance : le choix du contrat
Depuis 2010, crédit et assurance sont deux produits déliés. En vertu de la loi Lagarde, le prêteur n'a plus le droit d'imposer son contrat d'assurance en couverture du financement qu'il accorde. L'emprunteur est libre de choisir le contrat d'assurance et de faire jouer la concurrence en utilisant les comparateurs spécialisés qui aident les consommateurs dans leur recherche d'une formule adaptée au prix le plus bas.
Ce principe de délégation d'assurance signifie que vous pouvez souscrire un contrat alternatif au contrat bancaire, sous réserve qu'il présente une équivalence de niveau de garanties. Le marché de l'assurance de prêt se divise en effet en deux branches :
- les bancassureurs : les établissements de crédit commercialisent des assurances emprunteur via une filiale d’assurance ou en partenariat avec un prestataire. On parle de contrats groupe car ils sont négociés par la banque pour le compte de l'ensemble de ses clients.
- les alternatifs : les sociétés d'assurance (généralistes ou spécialisées) et les groupes mutualistes conçoivent et proposent des contrats qu'ils commercialisent en direct ou/et par l'intermédiaire des courtiers. Ces contrats sont individuels et personnalisés, et peuvent s'adapter à chaque situation et chaque profil d'emprunteur.
Ce marché est vaste et très concurrentiel, mais les banques ont la fâcheuse tendance à brimer toute tentative d'aller voir ailleurs, pour la bonne raison que le produit est très rémunérateur, générant des marges bancaires autour de 70%. Les marges de la concurrence sont nettement plus conformes à ce qui se pratique en assurance, entre 20% et 30%. En période de taux d'intérêts au plancher, les banques comptent sur l'assurance crédit pour se rémunérer... et sur l'ignorance du client quant à son droit au libre choix du contrat.
L'information : clef de voûte du libre choix
Lorsque vous faites une demande de crédit immobilier auprès d'une banque, celle-ci doit se soumettre à son devoir d'information et vous transmettre diverses informations dont certaines relatives à l'assurance de prêt. Dès la première simulation de crédit, la banque vous informe de vos droits en matière d'assurance de prêt, doit vous préciser le caractère facultatif ou obligatoire de l'assurance et vous remettre une Fiche Standardisée d'Information (FSI) qui stipule l'ensemble des garanties qu’elle exige pour l'octroi du prêt, accompagné d'un exemple chiffré du coût de l'assurance.
Cette FSI va vous permettre de comparer les offres sur la base des garanties requises par le prêteur. Elle doit contenir les informations suivantes :
- les garanties proposées : la banque détaille les différentes garanties qu'elle demande pour vous accorder le financement (décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité, incapacité, perte d'emploi), ainsi que les caractéristiques précises de ces mêmes garanties et les critères de couverture minimale pour chaque garantie (durée de la couverture, franchise, etc.).
- la quotité d'assurance : l'assurance doit couvrir 100% du capital emprunté. Pour un crédit à deux, la répartition peut être de 100% sur chaque tête pour une protection optimale, ou inégale en fonction du profil de chaque emprunteur (revenus, risques professionnels ou médicaux), pour une addition des quotités au moins égale à 100%.
- une estimation personnalisée du coût de l'assurance : le Taux Annuel Effectif Assurance (TAEA) représente le coût total de l'assurance en pourcentage annuel. La FIS mentionne également le coût total sur la durée du crédit, ainsi que le coût mensuel.
- le droit à la délégation d'assurance : la fiche vous rappelle que vous pouvez souscrire le contrat librement auprès de l'assureur de votre choix.
Les garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) forment le socle de tout contrat d'assurance de prêt. S'y ajoutent des garanties invalidité et incapacité pour couvrir les arrêts de travail. La garantie perte d'emploi est peu souscrite, même si la crise économique actuelle a renforcé la vigilance des prêteurs quant aux risques accrus de chômage dans certains secteurs sinistrés. La réglementation impose que la banque énumère au plus 11 critères sur les 18 formulés par le Comité Consultatif du Secteur Financier pour les garanties décès/PTIA et invalidité/incapacité, et 4 critères au plus sur les 8 réglementaires pour la couverture perte d'emploi.
La loi autorise de souscrire une assurance externe à la condition sine qua non que la couverture soit a minima aussi protectrice que celle du contrat groupe bancaire. À garanties équivalentes, un contrat externe individualisé peut être jusqu'à 4 fois moins cher que la proposition de la banque.
Cette information fondamentale, votre banque ne vous la donne pas ! Il vous faudra aller la chercher par un exercice de comparaison. Les comparateurs scannent toutes les offres du moment et sélectionnent pour vous, sur la base des informations que vous renseignez, les contrats adaptés à vos caractéristiques personnelles et à votre crédit.
Changer d'assurance en cours de prêt
Les banques détiennent 87% des cotisations annuelles d'assurance de prêt, un chiffre qui témoigne du peu de latitude dont bénéficient les emprunteurs malgré le principe de délégation d'assurance inscrit dans le marbre. Plusieurs raisons expliquent cette position dominante des bancassureurs :
- ils sont en pôle position pour proposer leur contrat maison, puisque ce sont eux qui distribuent les crédits ;
- les emprunteurs sont focalisés sur le taux d'intérêt, ignorant pour certains que la délégation est source d'économies importantes ;
- les banques usent et abusent de pratiques visant à dissuader l'emprunteur d'exercer son droit au libre choix du contrat (manœuvres dilatoires, dénigrement des contrats concurrents, demande indue de documents, refus non motivé).
Insistons sur le fait qu'une assurance déléguée vous permet de réduire le coût de la couverture et par extension, celui de votre crédit immobilier. En souscrivant une offre alternative à garanties équivalentes, vous pouvez économiser plus de 15 000€ sur la durée totale de votre prêt. N’est-ce pas suffisamment incitatif pour faire l’effort de comparer les offres grâce à un comparateur indépendant ? Après les intérêts d'emprunt, l'assurance est la deuxième dépense dans le coût total d'un crédit immobilier et comme les intérêts, elle se négocie.
Le gain potentiel concerne tous les profils d'emprunteurs, quels que soient les risques qu'ils incarnent. Si vous présentez des risques aggravés pour motifs de santé ou professionnels, seule l'assurance alternative peut vous proposer une protection sur-mesure et vous permettre de décrocher votre financement immobilier. Et si vous n'avez pu souscrire de contrat individuel lors de votre demande de prêt, vous avez la possibilité d'en changer une fois les fonds débloqués grâce aux deux dispositifs suivants :
- la loi Hamon : vous pouvez résilier le contrat d'assurance bancaire à tout moment durant les douze premiers mois au plus tard 15 jours avant la date d'anniversaire de signature de l'offre de prêt.
- l'amendement Bourquin : au-delà de la première année, vous pouvez substituer le contrat en cours tous les ans en respectant un préavis de deux mois avant la date d'anniversaire.
Toute démarche de résiliation/substitution doit respecter l'équivalence de niveau de garanties entre les deux contrats. La banque ne peut alors vous refuser le bénéfice de la délégation et si elle refuse le contrat alternatif, elle doit obligatoirement vous expliquer pourquoi, dans un délai de 10 jours ouvrés, afin que vous puissiez éventuellement engager une nouvelle demande de substitution.
L'aide précieuse d'un courtier
La banque tire les ficelles pour vous empêcher de souscrire une assurance alternative et se permet de contourner la loi qui, avouons-le, est entachée de lacunes, notamment quant à l'information sur la date retenue pour résilier. Malgré les nombreux et récurrents manquements constatés, peu de sanctions sont appliquées, alors qu'elles sont réglementaires, car il y a peu de contrôles de la part du régulateur.
Seul l'accompagnement d'un expert peut vous permettre de passer tous les obstacles (équivalence de garanties, délai de résiliation/substitution, présentation complète des documents), et de souscrire l'assurance correspondant à votre profil la plus compétitive. Grâce à sa connaissance du marché et des arcanes bancaires, le courtier va vous aider à sélectionner le contrat adapté conforme aux exigences de la banque et négocier à votre place auprès du prêteur.
Vous êtes lassé des démarches administratives ? On vous comprend. Après ce long parcours du combattant pour décrocher à l'arraché le financement de votre projet immobilier, vous n'avez guère envie de repartir pour un marathon de paperasserie. Les économies potentielles doivent faire tilt ! Chez Magnolia.fr, notre équipe s'occupe de toutes les démarches administratives, laissez-vous guider tout au long du parcours, depuis la sélection du contrat jusqu'à la transmission de l'attestation d'assurance à la banque.