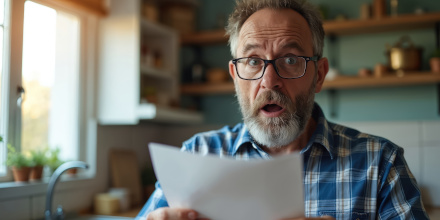Les taux d’usure du crédit immobilier affichent leur premier recul depuis trois ans, signe d’une détente des taux d’intérêts pratiqués au cours du trimestre précédent. Cette amélioration bénéficie au marché qui se redresse significativement depuis avril après de longs mois d’atonie. Le contexte politique actuel pourrait perturber ce début d’embellie.
Taux d’usure en recul au 1er juillet 2024
Le taux maximum légal pour les crédits immobiliers d’une durée de 20 ans et plus s’infléchit pour la première fois depuis 2021. La Banque de France fixe à 6,16% le taux d’usure sur ces maturités les plus longues pour le troisième trimestre 2024, contre 6,39% pour le deuxième trimestre. Pour les autres catégories de prêts immobiliers, les valeurs remontent ou stagnent.
Le taux d’usure pour les prêts à l’habitat de 20 ans et plus, qui représentent plus des deux tiers des nouveaux crédits accordés, cède ainsi 23 points de base. Cette baisse est l’illustration du reflux des taux d’intérêts pratiqués par les banques de détail au cours des trois mois écoulés.
Voici l’ensemble des taux d’usure selon la durée, applicables à compter du 1er juillet 2024 :
|
Catégorie |
Taux d’usure T2 2024 |
Taux effectif moyen pratiqué au T2 2024 |
Taux d’usure T3 2024 |
|
Prêts à taux d’une durée inférieure à 10 ans |
4,56 % |
3,45 % |
4,60 % |
|
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans |
6,13 % |
4,60 % |
6,13 % |
|
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus |
6,39 % |
4,62 % |
6,16 % |
|
Prêts à taux variable |
5,85 % |
4,48 % |
5,97 % |
|
Prêts relais |
6,76 % |
5,08 % |
6,77 % |
source Banque de France
Depuis le deuxième trimestre 2022, au moment où les taux d’intérêts ont commencé à prendre l’ascenseur, le taux d’usure n’a cessé de progresser. Pour les prêts sur 20 ans et plus, il était alors de 2,40%, le pic ayant été atteint au premier trimestre 2024 (6,39%). Cet écart permet de mesurer la nette dégradation des conditions d’emprunt dans un temps relativement cours. Entre décembre 2022 et mars 2024, les emprunteurs ont perdu près de 20% de pouvoir d’achat immobilier.
Taux d’usure : taux tout compris
Pour rappel, le taux d’usure est le taux maximum que les banques ne doivent pas dépasser. Il correspond au TAEG (Taux Annuel Effectif Global) maximum au-delà duquel aucun crédit ne peut être accordé.
Le TAEG est l’indicateur du coût global d’un crédit immobilier. Exprimé en pourcentage annuel de la somme empruntée, il agrège la totalité des frais liés à l’obtention du financement bancaire :
- intérêts d’emprunt exprimés par le taux nominal
- frais de dossier
- garantie (hypothèque ou caution)
- primes d’assurance emprunteur
- éventuellement les frais annexes (ouverture et tenue de compte, expertise du bien immobilier, parts sociales d’une banque mutualiste, frais de courtage).
Le TAEG doit être indiqué dans tous les documents commerciaux, pré-contractuels et contractuels, et permet de comparer le coût global des propositions bancaires.
Retour au calcul trimestriel
Il faut rappeler que le taux d’usure n’a pas toujours été révisé chaque trimestre. Durant l’année 2023, la Banque de France avait tardivement décidé de procéder à une actualisation mensuelle du taux d’usure afin d’éviter les effets délétères de l’évolution trop rapide des conditions monétaires. La remontée brutale des taux d’intérêts, sous l’impulsion de la politique de la Banque Centrale Européenne en vue de maîtriser l’inflation, rendait les taux d’usure très vite obsolètes, ce qui avait pour dérive de provoquer l’exclusion du crédit de ménages pourtant solvables.
Modifiés tous les mois, les taux d’usure offraient aux établissements bancaires une marge de manœuvre plus grande pour adapter leurs barèmes de taux. La reprise du calcul trimestriel depuis janvier 2024 est le signe d’un retour à la normale. L’inflation en zone euro tend vers son objectif des 2% (2,6% sur un an en mai 2024) et le 6 juin dernier, la BCE a pu assouplir ses taux directeurs de 25 points de base, une première depuis 2016.
Reprise du crédit immobilier en avril
La fonte des taux d’intérêts enclenchée en janvier dernier permet au marché immobilier de rebondir. Selon les chiffres de la Banque de France, la production de crédits à l’habitat (hors renégociations) a progressé de 29% sur un an en avril 2024. Il s’agit d’un « premier retournement de tendance significatif depuis le printemps 2022 et la remontée des taux ». Les projections indiquent que ce mouvement a dû se poursuivre en mai.
Les données de l’Observatoire Crédit Logement témoignent en effet d’un dynamisme retrouvé, la production de crédits immobiliers ayant bondi de +74,1% entre décembre 2023 et mai 2024 (+86,2% en nombre de prêts accordés). En niveau annuel glissant, l’activité reste toutefois en retrait, de -34,7% en production de crédits et de -25% en nombre de prêts.
Actuellement, le taux moyen du marché sur 20 ans tourne autour de 3,85% (hors assurance emprunteur et coût des sûretés), loin des 4,50% observés en décembre 2023. Les dossiers premium peuvent obtenir une décote substantielle pouvant descendre à 3,40%.
Le redémarrage de l’activité pourrait être compromis par le contexte politique en France. Les législatives 2024 constituent une menace sur les conditions de crédit immobilier. L’arrivée probable d’un gouvernement RN au lendemain du deuxième tour le 7 juillet inquiète les marchés financiers en raison des risques budgétaires. Signe d’une défiance des investisseurs, le rendement à 10 ans de la dette française a atteint un niveau inédit depuis novembre dernier, à 3,20%. La réaction des investisseurs face à ce tournant politique majeur reste pour le moment mesurée. Jusqu’à quand ?